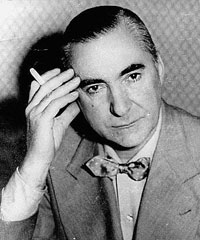Le bachot c'est chaud
On pourrait s'abstenir ici de parler du baccalauréat, tant tout semble être dit chaque année sur la chose. Tant les clichés sont remâchés par tout ce qui prétend informer, tant ces clichés sont réfutés par d'autres clichés. Chaque année à la même époque, c'est la fête aux gogos et aux demi-habiles.
Le bac couperet. Le bac bradé. L'excellent cru. Le rite de passage. Le bac qui ne veut plus rien dire. L'angoisse à deux jours du coup d'envoi. Les soupçons de fuite, de fraude. Jean d'Ormesson qui décortique avec gourmandise le sujet de philo. Le scandale des quarante copies égarées – la France entière doit-elle repasser l'épreuve ? La mention les doigts dans le nez. Les prodiges à 21 sur 20 de moyenne (c'est sûrement à cause de l'option latin – faut-il supprimer le latin?). Le doyen des candidats (94 ans, ça tremblote mais ça y croit). La benjamine (12 ans et demi, rien à signaler). Les cris de joie devant le tableau des résultats. Jessica qui n'est pas loin de pleurer (elle va au rattrapage, 97 points de retard, jouable mais pas gagné). Quentin qui l'a eu il se demande bien comment il réalise pas il avait rien glandé ses profs vont faire une de ces tronches sa maman est émue il va faire une teuf bien méritée après on verra. Capucine et Victoire qui ont eu mention Très bien parce qu'elles s'appellent Capucine et Victoire (salopes). L'épreuve d'histoire trop dure cette année (il y avait le mot « Staline » dans le document B, sans note explicative), pétitions en circulation, la fronde prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Le budget du bac trop lourd (trois fois le PIB de l'Ouzbékistan). La nécessité d'un allègement, d'un dépoussiérage, d'un aggiornamento. Le tabou de sa suppression. Les Français attachés à ce symbole fort de la méritocratie républicaine.
Ces voix discordantes et gentiment schizophrènes indiquent un état de panique avancé. C'est que les enjeux du bachot ont évolué avec le temps et l'inflation des résultats mirifiques, comme le résume avec un cynisme aussi juste que cruel un article de la revue Phosphore : « Sans le bac tu es rien, avec le bac tu as rien ». Le bac, condition nécessaire mais archi-insuffisante. Même avec Mention Bien tu peux commencer à devenir insomniaque : les études supérieures ne seront pas du gâteau, vaut mieux pas regarder de trop près les stats d'échec en licence (et quand la licence sera obtenue plus facilement par un plus grand nombre, vaudra mieux pas regarder de trop près les courbes de chômage et de précarisation des licenciés). Moyennant quoi, des experts de la chose éducative considèrent que trop de jeunes encore n'ont pas accès au bac ; si tout le monde pouvait enfin le décrocher, c'est sûr que tout irait tout de suite mieux à tous les échelons de la société. C'est tellement logique. Et ça permettrait à Phosphore d'écourter son analyse : « Avec le bac, t'as vraiment rien de rien».
Qu'en est-il des épreuves de français, qui ont l'insigne honneur de se mettre en travers de la route des élèves en classe de première – et auxquelles on s'initie dès la seconde ? S'agit-il de sanctionner un niveau de maîtrise de la langue, de la pensée critique, d'évaluer des connaissances jugées fondamentales pour l'honnête homme et la citoyenne du XXI° siècle, la créativité ou la pertinence du regard sur les grandes questions qui se posent à cet âge crucial ? Surtout pas, rien de tout ça. Ce serait trop vulgaire. Trop premier degré, trop téléphoné. Non non, au lycée en français, il s'agit de vérifier que tous les élèves ont acquis des compétences d'analyses littéraires affûtées, que tous sont aptes à devenir des étudiants de Lettres modernes. Pas seulement en prenant la littérature comme point d'appui, mais en se concentrant exclusivement sur la littérarité des textes littéraires. L'écrit de français ? Trois sujets au choix : tu dissertes sur des problématiques littéraires, ou tu commentes les procédés littéraires d'un texte de littérature, ou tu inventes un discours méta- ou simili-littéraire à partir d'une situation littéraire (l'écriture dite d'invention que d'aucuns appellent « dissertation déguisée »). A l'oral, attention ! brusque changement, compteurs remis à zéro, dépaysement garanti : tu fais une explication littéraire d'un texte de littérature et on t'interroge ensuite sur les à-côtés littéraires du texte (à partir d'autres textes littéraires ou d'œuvres littéraires ou parfois – audace folle ! ouverture maximale sur le vaste monde ! - d' allusions à d'autres arts).
Nous voilà donc avec des épreuves de spécialistes, des exercices étrangement proches les uns des autres, resserrés autour de quelques questions restreintes - d'où les mêmes types de textes et d'énoncés qui reviennent de manière récurrente. Perspectives quasi universitaires dont la légitimité serait déjà douteuse si elles ne concernaient que 3% d'une classe d'âge. Alors là... Voudrait-on évaluer avec rigueur les travaux qui nous sont soumis, ce serait un sanglant carnage. Pour éviter le pire et sachant qu'on ne va changer ni les candidats ni les épreuves, les hautes instances ont trouvé la solution ad hoc : il nous est demandé de faire la part des choses, de noter en tenant compte de, en valorisant ceci, en évitant de trop sanctionner cela. On nous conseille d'utiliser tout l'éventail des notes, si possible dans la partie haute de l'éventail. Ne pas hésiter à mettre 20/20 (de fait, certains collègues, qui avaient sans doute une terrible fringale dans les temps antérieurs, n'hésitent plus du tout). Réfléchir à deux fois avant de mettre 6 ou en dessous (la copie sera relue dans ce cas pour être certain que tu n'as pas eu la main trop lourde, espèce de sale survivance élitiste). Et c'est ainsi que chaque année on se doit d'absorber des copies objectivement faibles et bancales avec des moyennes académiques lentement mais sûrement en hausse.
Les élèves savent tout cela. Ils savent que ça ne se finira pas trop mal, même s'ils en bavent tout au long de l'année face à ces exercices hors de leur portée. C'est ainsi qu'on arrive à perdre sur tous les tableaux : des objectifs intenables et à côté de la plaque, des exigences superlatives répétées pendant deux ans et in extremis revues à la baisse, par la force des choses ; et des élèves qui réussissent à moitié au bout du compte, sans être ni plus heureux ni plus cultivés. Tu le vois, le moche paradoxe, l'oxymore persistant ? L'écrit de français, c'est cette énigme à la fois insoluble et fastoche. Ce précipice géant qu'on enjambe distraitement. Cette grosse couleuvre qu'on avale cul sec. Cette grenade à fragmentations qui nous explose à la figure en faisant pshiiiiit.
Et l'oral ? Le candidat a mémorisé un certain nombre d'explications de textes, et il crache et crache et crache encore son cours en donnant l'impression qu'il croit à ce qu'il dit – parfois, petit miracle, c'est le cas. Là encore, les contenus longuement ressassés ne sont pas les plus épanouissants du monde. Mais au moins, à l'oral, il y a une forme de rationalité et, osons le mot, de justice. Les jeunes largués - ceux qui ne sont pas les amants prédestinés de la Littérature envisagée dans sa littérarité - peuvent quand même, avec des efforts répétés et constants, en bachotant donc, sortir victorieux de l'épreuve. C'est sans doute pour cette raison que pas mal de voix s'élèvent pour dénoncer cette porte ouverte au psittacisme rentable. Que les élèves très travailleurs puissent obtenir de très bons résultats inquiète beaucoup le mammouth. Il voudrait les prendre un peu plus au dépourvu. Pour leur bien, hein.
On me trouvera peu enthousiaste, on se demandera si je ne voudrais pas en finir avec ce bon vieux bachot - premier grade universitaire, comme aiment à rappeler les crétins. Franchement ? Franchement j'hésite. D'un côté la disparition de ce machin pénible et dévalué permettrait d'être plus libre dans sa classe, de prendre de la hauteur, de ne pas s'enferrer dans des consignes asphyxiantes – et ça ne changerait rien aux études supérieures, puisque de toute façon les inscriptions se font avant le bac et que la grande majorité des formations qui sélectionnent s'appuient sur les notes en continu, en dehors du bac. D'un autre côté, c'est bien l'unique occasion, pour un certain nombre d'élèves, de travailler vraiment, de réviser une masse conséquente et même – rêver n'est pas interdit – de retenir deux ou trois détails dignes d'intérêt. Et puis, quoi qu'on en dise, il y a le cérémonial de l'examen. Ce léger frisson (ou cette franche colique) qui s'empare du jeune candidat soudain conscient qu'il va jouer sa chance sur deux épreuves, là, comme ça, en si peu de temps, que son niveau va être jugé par un correcteur anonyme et un examinateur inconnu. Quand on voit certaines conséquences de l'effroi suscité – le gars qui émet des glougloutements entre deux phrases difficilement dégluties, la fille tellement en panique qu'elle en devient clepto et quitte l'épreuve en embarquant toute la surface de la table, y compris la trousse et les feuilles de l'interrogateur – on se dit que ce premier contact avec le monde des entretiens décisifs n'est pas du luxe. Il vaut mieux s'être décomposé une première fois devant un prof somme toute inoffensif que de découvrir le phénomène des années après, au moment où il s'agira de convaincre un jury de concours ou de se faire embaucher...
Ce que je pense en définitive ? Que les épreuves du bac de français sont à revoir de fond en comble. Mais comme je ne décide rien, poursuivons, et évaluons avec toute la bienveillance dont nous sommes capables.